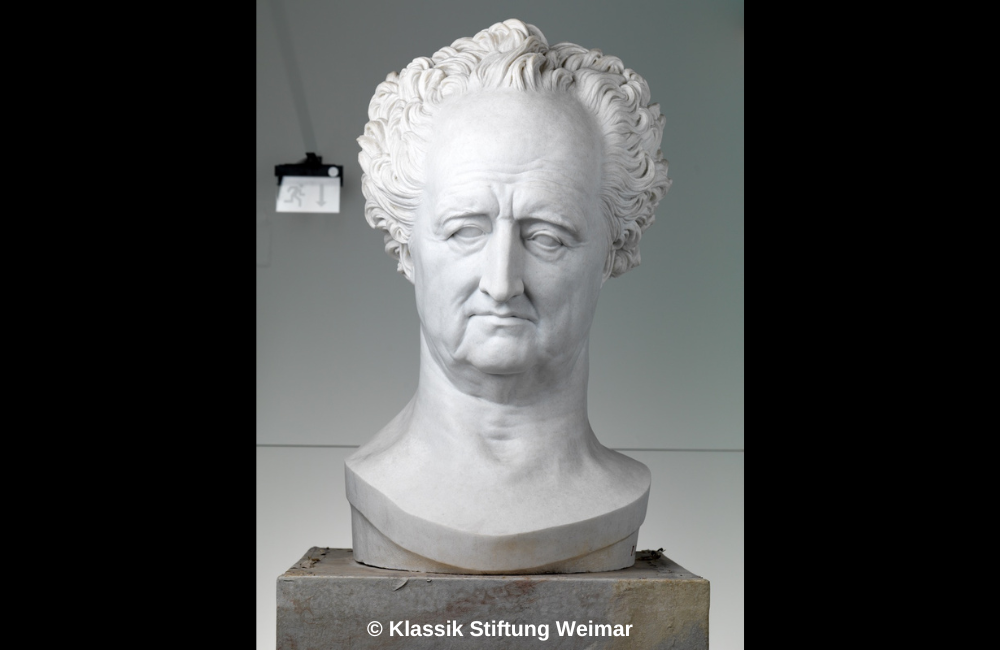GOETHE : L'ACTUALITÉ D'UN INACTUEL
DU LUNDI 20 AOÛT (19 H) AU LUNDI 27 AOÛT (14 H) 2018
[ colloque de 7 jours ]
DIRECTION :
Christoph KÖNIG, Denis THOUARD, Heinz WISMANN
ARGUMENT :
Le nom de Goethe est célèbre et on mesure son importance, mais sans le lire vraiment. L'œuvre se présente au lecteur comme un cosmos inaccessible. L'observateur perspicace de son temps fut aussi résolument étranger à son époque et fut constamment perçu comme parfaitement inactuel. Il faut d'abord pénétrer, au moyen d'une lecture insistante, dans le monde de ses œuvres et dans leur idiosyncrasie pour découvrir leur actualité. De grands lecteurs tels que Nietzsche, Freud, Gide, Benjamin et Kafka se sont nourris, en actualisant son œuvre, de l'inactualité systématique de Goethe. C'est à cette figure de créativité que sera consacré le présent colloque. L'œuvre de l'âge mûr — le Divan occidental-oriental, les Années de voyage de Wilhelm Meister et le Faust. Deuxième partie — occupera une place centrale : Goethe retourne cette créativité contre ses propres œuvres et leur confère une dimension fortement réflexive. Comment Goethe a-t-il pu échapper à son propre classicisme ? Comment, ayant édifié sa propre statue, Goethe parvient-il à y échapper, à se réinventer autrement dans son œuvre tardive, devenant peut-être un "second auteur" à l'ombre du premier ? Les discussions interrogeront la figure de ce Goethe méconnu, encore sous-estimé et pourtant plus porteur d'avenir que l'icône du classicisme weimarien.
Les intervenants ayant particulièrement étudié ces aspects négligés de l'œuvre, seront attachés à faire apparaître les résonances actuelles de celle-ci, dans ses aspects scientifiques, sa distance instruite avec la philosophie, mais aussi dans son ouverture aux littératures du monde, dont il fut le pionnier, et dans la réinvention de la figure de l'auteur.
CALENDRIER DÉFINITIF :
Lundi 20 août
Après-midi
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée
Présentation du Centre, des colloques et des participants
Mardi 21 août
LE DEUXIÈME AUTEUR
Matin
Michael FORSTER : Goethe et Hegel : le rôle de Faust dans la "Phénoménologie de l'esprit" (1807)
Christoph KÖNIG : Le statut d’auteur second comme procédé poétique dans la Nuit de Walpurgis classique
Après-midi
Anne LAGNY : Le théâtre dans l'œuvre tardive
Denis THOUARD : Du vieillissement : réflexion
Mercredi 22 août
SCIENCE, PHILOLOGIE, HISTOIRE, PHILOSOPHIE
Matin
Eli FRIEDLANDER : Goethe et Benjamin : de la Nature à l'Histoire
Bruno HAAS : Théorie des couleurs et phénomène originaire dans le contexte de la crise du langage autour de 1800
Après-midi
Atelier de lecture, avec Christoph SCHMÄLZLE : La réflexion de Goethe sur l'Art - Le groupe du Laocoon
Mildred GALLAND-SZYMKOWIAK : Symbolisme et théâtralité
Soirée
"Élégies croisées", lectures d'extraits de Bessette et de Goethe, suivies d'une discussion | Avec le colloque en parallèle Hélène Bessette : l'attentat poétique
Jeudi 23 août
LA FORME MODERNE DES ŒUVRES
Matin
Bernhard FISCHER : L'"agrégat" de Goethe : Les Années de voyage de Wilhelm Meister (1829)
Kirk WETTERS : "Voici venu le temps de l'unilatéralité". Spécialisation, différenciation et métier dans Les Années de voyage de Wilhelm Meister
Après-midi
DÉTENTE
Vendredi 24 août
PRISES DE POSITION ET AUTORÉFLEXION
Matin
Beatrice GRUENDLER : La poésie arabe comme tradition du Divan occidental-oriental
Atelier de lecture, avec Christoph KÖNIG : Philologie et créativité dans le Divan occidental-oriental
Après-midi
Werner WÖGERBAUER : L'art poétique des "Élégies romaines" [enregistrement audio en ligne sur La forge numérique de la MRSH de l'université de Caen Normandie et sur le site Radio France, rubrique France Culture]
Atelier de lecture, avec Christoph KÖNIG & Denis THOUARD : Élégie de Marienbaed
Samedi 25 août
CRITIQUE HISTORIQUE DES INTERPRÉTATIONS
Matin
Michael WOLL : De Goethe à Celan : le potentiel du Divan pour la poésie du XXe siècle
Alexandra RICHTER : La métamorphose comme paradigme philosophique : Walter Benjamin, lecteur des écrits scientifiques de Goethe
Après-midi
Roland KREBS : La Réception de Goethe en France dans les années 1930 et aujourd'hui
Christian HELMREICH : Soulever le voile d'Isis. Science de la nature chez Alexandre de Humboldt et Goethe
Dimanche 26 août
LA LANGUE DE LA TRADUCTION
Matin
François THOMAS : Goethe, penseur de la traduction
Guillaume MÉTAYER : Nietzsche et Goethe : épigramme et inactualité
Après-midi
Atelier de lecture, avec Elisabeth DÉCULTOT : La traduction comme dialogue critique: Goethe et Diderot sur la peinture
Soirée
Goethe en musique, avec Julien SÉGOL (baryton basse) et Kunal LAHIRY (pianiste)
Lundi 27 août
CONCLUSION
Matin
Dialogue entre Adolf MUSCHG et Christoph KÖNIG
Après-midi
DÉPARTS
SOUTIENS :
• Fondation Thyssen
• Université d'Osnabruck
• Goethe-Institut
• Association "l'art de lire"
• Centre Georg Simmel